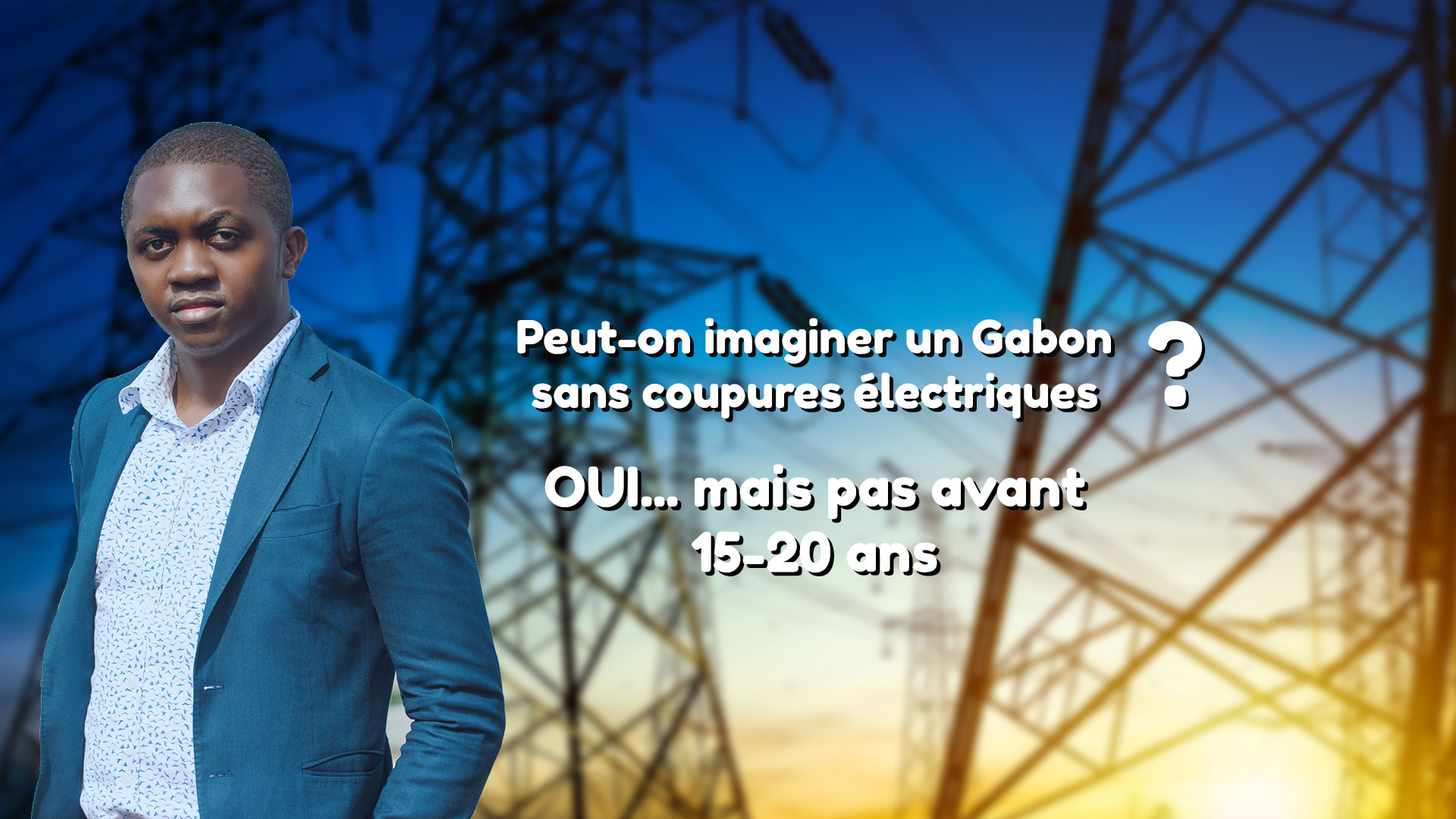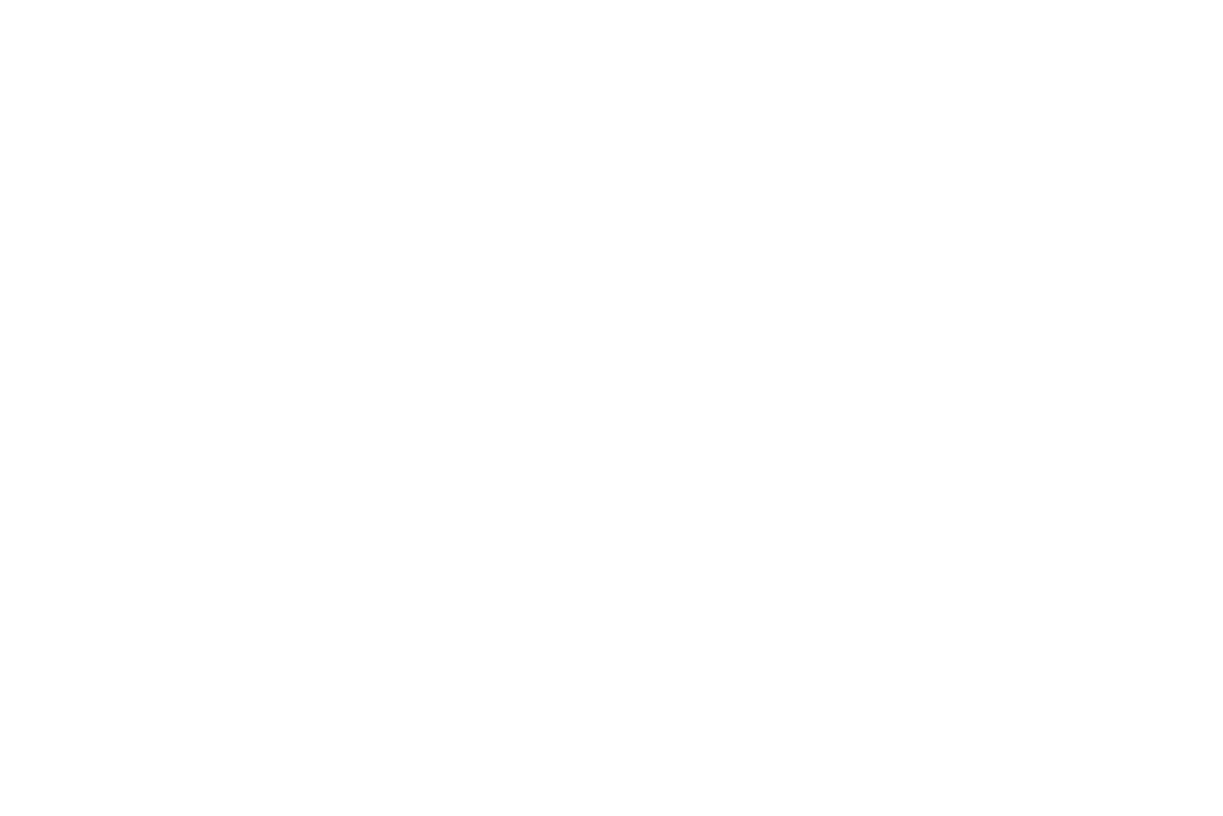Tout d’abord, il est important de préciser que le problème n’est pas la coupure elle-même. Des coupures, il y en aura toujours, partout dans le monde. La vraie question, c’est : combien de temps dure-t-elle ?
Combien en subissons-nous dans l’année ? Et surtout, arrivons-nous à réduire ce temps jusqu’à quasi zéro grâce à un réseau plus résilient ?
Pour comprendre le phénomène, plusieurs facteurs et non exhaustifs, méritent d’être examinés : la fiabilité du réseau et ses indicateurs, l’impact du climat, l’état du réseau interconnecté, la production face à une demande croissante, la vétusté des équipements, la manière dont les coupures sont traitées et, enfin, les solutions pour y remédier de façon durable.
Un climat tropical qui fatigue le réseau
Le Gabon est un pays à climat équatorial, chaud et humide, avec deux saisons bien marquées : une longue saison des pluies, de septembre à mai, et une saison sèche plus courte, de juin à août. Durant la saison des pluies, les précipitations peuvent atteindre plus de 2500 mm par an à Libreville uniquement, avec une humidité constamment élevée et de fréquents orages. Ces conditions accélèrent la corrosion des lignes électriques, fragilisent les isolants et multiplient les risques de panne. La foudre provoque régulièrement des coupures instantanées, et la chaleur permanente use prématurément les matériaux.
Mais le climat agit aussi sur la demande. En période de pluie, la chaleur constante pousse la consommation à la hausse, notamment avec l’utilisation accrue de climatiseurs et ventilateurs. C’est aussi la période où les aléas météorologiques créent le plus d’incidents : poteaux abattus par les intempéries, inondations perturbant les postes électriques, voire accidents routiers provoqués par la pluie qui endommagent les infrastructures.
En saison sèche, c’est une tout autre image : les températures sont plus douces, la demande baisse, il n’y a ni fortes pluies ni foudre, et donc moins de perturbations techniques. Cette accalmie donne souvent l’impression que les coupures ont disparu, mais ce n’est qu’une illusion : les neuf autres mois de l’année restent soumis à une pression intense, à la fois sur la demande et sur le réseau.
Le TIN, thermomètre de la continuité de service
Pour mesurer la qualité de fourniture d’électricité, on utilise notamment le Temps d’Interruption Normé (TIN), qui indique la durée moyenne d’une coupure ressentie par un client sur une période donnée; bien que le SAIDI et le SAIFI apportent plus de précision. Entre 2014 et 2024, le TIN moyen au Gabon a connu des variations extrêmes, allant de quelques minutes par an en 2015 à plus de 1 800 minutes en 2019, soit plusieurs dizaines d’heures. La moyenne décennale s’élève à environ 539 minutes par an (9 heures), un chiffre bien supérieur aux standards internationaux : environ 10 minutes en France et 50 minutes au Maroc.
Derrière ces moyennes nationales se cachent de fortes disparités régionales. Entre 2014 et 2023, Booué, Makokou et Mitzic ont enregistré les TIN les plus élevés, avec respectivement environ 12, 9 et 7 minutes de coupure par jour.
En 2024, Tchibanga, Port-Gentil et Minvoul ont été les plus touchées, dépassant parfois 100 heures de coupures cumulées sur l’année. Ces chiffres rappellent que pour une partie de la population, les coupures sont encore une réalité quasi quotidienne.
Pourquoi tant de coupures ?
Les causes sont multiples et s’additionnent. Le réseau gabonais est segmenté en plusieurs zones interconnectées (RIC de Libreville, Franceville, Louetsi…), mais ces zones ne sont pas reliées entre elles. En cas de surplus dans une région, il est impossible de transférer cette énergie vers une autre en difficulté. À cela s’ajoute une production souvent insuffisante face à une demande qui croît de 3 à 4 % par an, stimulée par l’urbanisation, la croissance démographique et les projets structurants comme le nouvel aéroport, la ville nouvelle Libreville 2 ou les zones industrielles et agro-industrielles.
S’y ajoute un problème de fond : la vétusté des équipements. Certaines installations ont plus de 20 ans et n’ont jamais bénéficié de maintenance préventive. Les interventions se font principalement en mode curatif, c’est-à-dire uniquement lorsqu’une panne majeure survient, ce qui prolonge le temps de coupure et augmente les risques de défaillances répétées.
Enfin, le traitement des coupures est souvent long. Dans la majorité des cas, la détection de la panne repose encore sur des signalements manuels, suivis d’un déplacement physique des équipes pour localiser et réparer. Cette méthode prend du temps, surtout lorsque les zones à inspecter sont étendues. Pourtant, des solutions existent : l’installation d’interrupteurs aériens télécommandés par exemple, dans les réseaux de distribution permettrait de segmenter rapidement la zone en défaut et de réalimenter instantanément les clients non affectés. Aujourd’hui, les plus gros investissements se concentrent sur la production, alors que c’est au niveau de la distribution que les coupures sont les plus ressenties par les usagers.
Vers un réseau plus résilient
Réduire le temps de coupure à quelques minutes n’est pas un rêve inaccessible, mais cela suppose une stratégie globale et un investissement constant. Il ne s’agit pas seulement de produire plus : il faut investir dans tout le cycle, la production, le transport, la distribution et même la partie commerciale.
Dans la production, il faut diversifier les sources, intégrer davantage de renouvelables avec stockage et renforcer les marges de réserve pour absorber les pointes de consommation. Dans le transport, la priorité est la sécurisation et la fiabilisation du système de protection, avec des équipements capables d’isoler instantanément une panne et d’éviter les effets en cascade. Dans la distribution, la modernisation passe par l’installation généralisée d’interrupteurs télécommandés et la mise en place de smart grids : des réseaux intelligents qui détectent, isolent et rétablissent automatiquement l’électricité sans intervention humaine. Enfin, dans la partie commerciale, un suivi précis des incidents et une communication transparente avec les usagers permettent d’anticiper et de mieux gérer les périodes critiques.
Pour que ces mesures portent leurs fruits, le budget alloué à l’énergie doit passer de 1-2 % à au moins 5-10 % du budget national, et être maintenu sur le long terme. L’électricité doit être considérée comme un investissement stratégique permanent, et non comme une dépense ponctuelle.
En concluson, penser qu’on pourra un jour éliminer totalement les coupures au Gabon, c’est ignorer les réalités climatiques et techniques de notre territoire. Le vrai défi est ailleurs : construire un réseau capable de détecter et de traiter les coupures rapidement, de façon à ce qu’elles deviennent rares, brèves et quasiment invisibles pour l’usager.
Atteindre cet objectif nécessitera une vision claire, un engagement politique fort et des investissements constants dans toutes les composantes du réseau. Si le chemin est encore long, au moins 15 à 20 ans, il est possible de transformer en profondeur notre système électrique. Un Gabon où les coupures ne freinent plus la vie quotidienne ni le développement économique n’est pas une utopie : c’est une perspective réaliste, à condition de commencer dès maintenant.
Steven OBAME